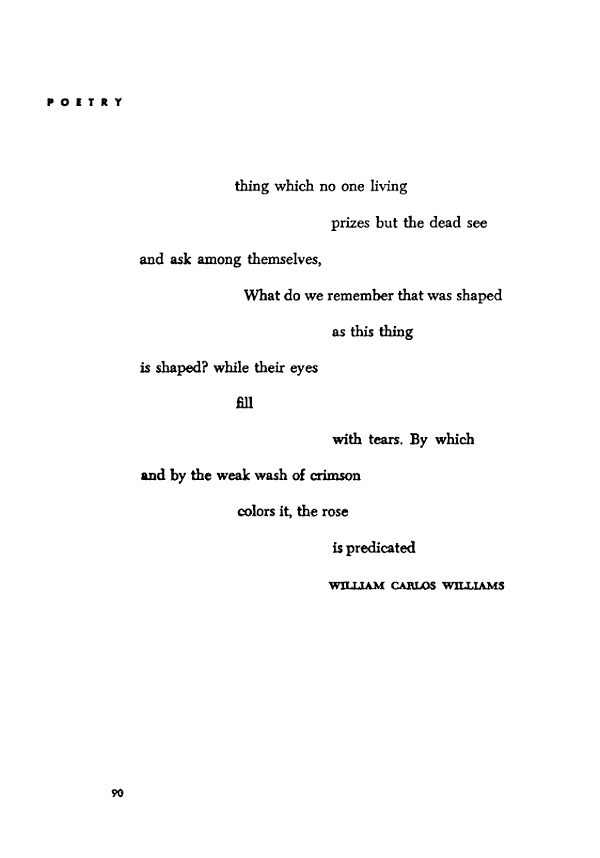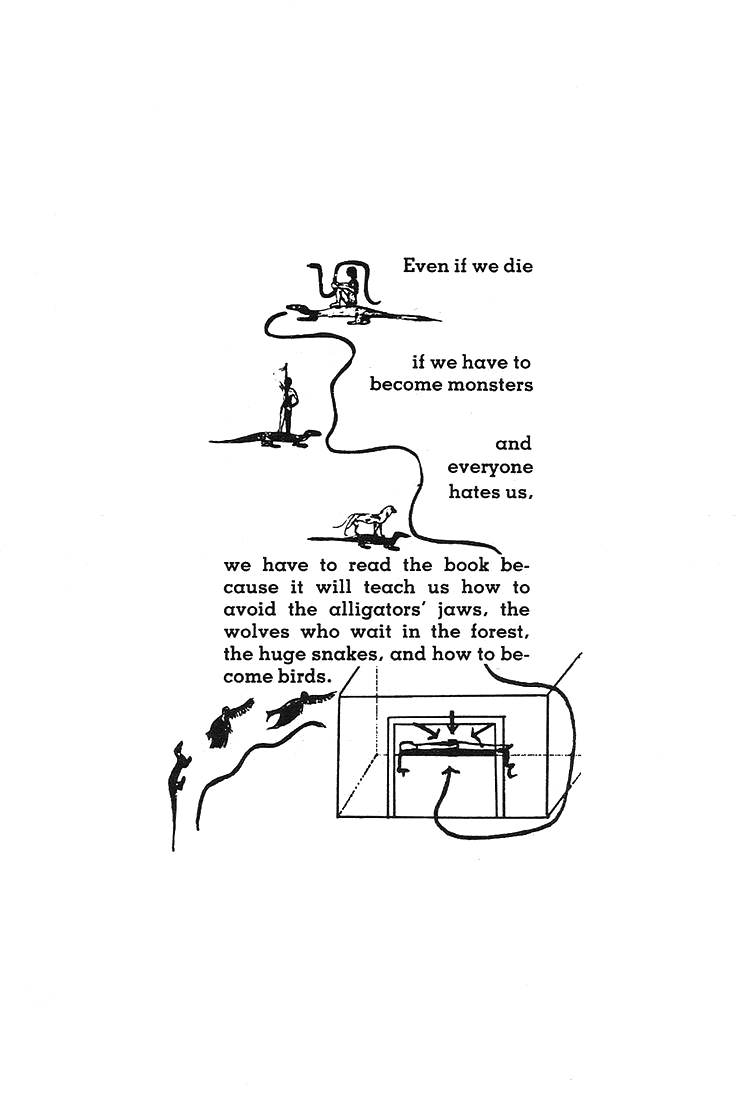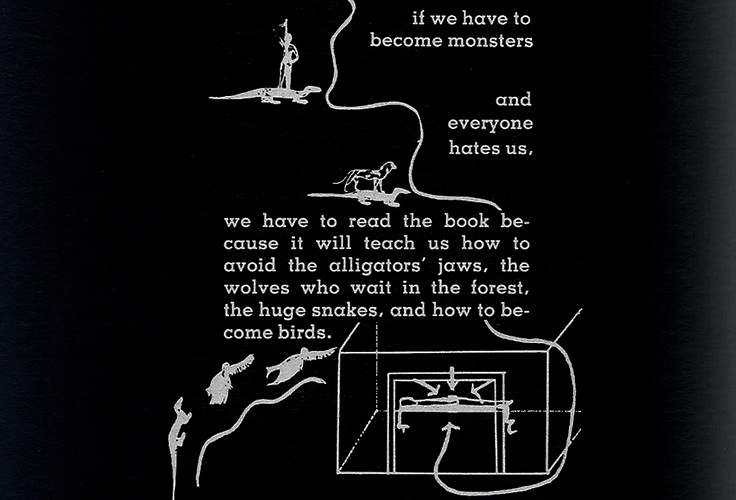
A travers l’espace feuilleté des vingt-sept pairs, Faustroll évoqua vers la troisième dimension : De Baudelaire, le Silence d’Edgar Poe, en ayant soin de retraduire en grec la traduction de Baudelaire. De Bergerac, l’arbre précieux auquel se métamorphosèrent, au pays du Soleil, le rossignol-roi et ses sujets. De Luc, le Calomniateur qui porta le Christ sur un lieu élevé. De Bloy, les cochons noirs de la Mort, cortège de la Fiancée. De Coleridge, l’arbalète du vieux marin et le squelette flottant du vaisseau, qui, déposé dans l’as, fut crible sur crible.
—Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, roman néo-scientifique: suivi de Spéculations, 1929
1. Un auto-encodeur1 est un réseau de neurones ayant pour tâche d’apprendre à produire de façon autonome des fac-similés d’objets du monde extérieur, par une sorte de processus de tâtonnements successifs (trial and error). Nous appellerons « Hal » un auto-encodeur hypothétique et exemplaire, et « ensemble d’apprentissage » la totalité des entrées que demanderons à Hal de reconstruire – par exemple, un très grand nombre de fichiers image de visages humains, de fichiers audio de bruits de jungle, de scans de cartes de villes. Lorsque Hal reçoit un fichier média x, sa fonction caractéristique sort une brève liste de courts nombres, et sa fonction décodeur tente de recréer le fichier média x à partir du « résumé » de x produit par la fonction caractéristique. Bien sûr, puisque la variété des fichiers média possibles est bien plus grande que celle des brèves listes possibles de courts nombres, quelque chose se perd forcément lorsque les fichiers média sont traduits en valeurs caractéristiques, et vice versa : de nombreux fichiers média se traduiront dans la même liste de courts nombres, mais chaque liste ne peut se retraduire qu’en un seul fichier média. Toutefois, en tentant de limiter les dégâts, Hal apprend – par tâtonnements successifs – un schéma effectif ou un « vocabulaire mental » pour son ensemble d’apprentissage, exploitant ainsi les riches motifs holistes contenus dans les données au cours de son processus de résumé et de reconstruction. Les « résumés » produits par Hal deviennent en fait une cartographie cognitive de son ensemble d’apprentissage, une sorte de compétence gestaltique qui le façonne de manière ambiante comme une niche ou un monde vécu.
2. Un algorithme auto-encodeur n’apprend pas à réaliser des reconstructions parfaites ; il apprend un système de caractéristiques capable de générer une reconstruction approximative des objets contenus dans l’ensemble d’apprentissage. En fait, la différence entre un objet de l’ensemble d’apprentissage et sa reconstruction – en termes mathématiques, l’erreur de reconstruction de l’objet par l’auto-encodeur entraîné – démontre que l’on pourrait parler, de façon assez littérale, d’un excès de la réalité matérielle sur la logique gestaltique-systémique de l’auto-encodage. Dans cet esprit, appelons canon de S l’ensemble de toutes les entrées possibles pour lesquelles un auto-encodeur entraîné S ne fait aucune erreur de reconstruction. Le « canon » est donc l’ensemble des objets qu’un auto-encodeur entraîné, dont la capacité d’imagination est limitée à une poignée de « respects de variation » – les dimensions du vecteur caractéristique –, peut imaginer ou concevoir sans approximation ni simplification. De plus, si l’auto-encodeur a été entraîné avec succès, les objets contenus dans le canon exemplifient collectivement une idéalisation ou une simplification d’objets du monde. Enfin, chose tout à fait frappante, un auto-encodeur entraîné et son canon sont effectivement équivalents l’un à l’autre sur le plan mathématique : il n’y a pas seulement entre eux une grossière équivalence logique, mais on peut aisément et rapidement passer de l’un à l’autre. En fait, l’auto-encodage d’un petit échantillon du canon de l’auto-encodeur entraîné S suffit à répliquer ou à modéliser S avec exactitude.
3. Imaginons, si vous le voulez bien, que « l’herméneutique du soupçon2 » – interprétation symptomatique ou subversive typique de l’univers académique des années 1990 – était un processus d’exploration de données consistant à inférer, à partir de ce que contient et ne contient pas le monde construit par un texte littéraire, un organon (un système de pensée et de sentiment) qui rend certains phénomènes du monde réel impensables, invisibles et forclos pour l’ordre des choses. À partir de l’observation de la sélection de phénomènes opérée par l’œuvre littéraire, le critique inférera un modèle génératif de l’œuvre et trouvera ce que le texte refoule ou marginalise dans les « trous » du modèle génératif : des états du monde vécu que le modèle génératif ne peut générer. Un critique ambitieux ira encore plus loin, et tentera de caractériser les dimensions – les manières significatives dont les états du monde peuvent différer les uns des autres – manquant dans le modèle génératif. La plupart des lectures contemporaines relevant du matérialisme culturel ou sensibles à l’idéologie sont « post-soupçon », comme l’explique Rita Felksi dans « After Suspicion3 » : les critiques littéraires actuels s’inspirant de la théorie sociale, surtout ceux qui sont associés au champ des affect studies, tendent à se démarquer de leurs prédécesseurs dans la mesure où ils attribuent une réflexivité et une capacité d’agir aux textes littéraires, en tant que facilitateurs d’une comparaison critique entre le modèle et le monde. Ce tournant moderne établit un rapprochement entre le cadre de certains critiques s’inspirant de la théorie sociale – en particulier, Jonathan Flatley et Sianne Ngai4 – et le nôtre. Plus précisément, dans Ugly Feelings, Ngai avance une thèse capitale : une œuvre littéraire peut représenter, par sa tonalité, l’idéologie d’un sujet – donc à la fois représenter une structure de sa subjectivité et toucher du doigt la structure des conditions sociales matérielles structurant sa subjectivité. Il y a là une forte concordance avec la proposition selon laquelle les systèmes de « respects de variation », que l’on pourrait définir par la réalité matérielle en excès qu’ils marginalisent (c’est-à-dire, définir comme « idéologie »), peuvent être identiquement définis par l’unité esthétique des réalités matérielles auxquelles ils sont le plus à même d’accéder (c’est-à-dire, définis comme « tonalité »). Nous avancerons que le canon d’un auto-encodeur entraîné récapitule l’idéologie d’un système de « respects de variation » comme tonalité.
4. Nous savons que les auto-encodeurs traitent intégralement des mondes rendus sous l’aspect d’ensembles d’objets ou de phénomènes. Quelles que soient les structures mondaines plus profondes que le schéma d’un auto-encodeur apporte à l’interprétation d’un objet, ces structures sont déjà à l’œuvre, sous une forme ou sous une autre, dans l’esthétique collective des objets sur lesquels elles règnent5. Je souhaite envisager cette structure de production de monde, esthétiquement accessible et accessible à la surface, comme le substrat mathématique de ce que l’auteur et musicien Ezra Koenig appelle « vibe » :
Au cours de mes recherches sur le fonctionnement du charme et de la musique pop, je suis tombé sur Internet Vibes, un blog tenu par Ezra Koenig en 2005-2006, dans le but de catégoriser autant de « vibes » que possible. Par exemple, une « vibe pluvieuse/grise/britannique » intègre une promenade d’une boutique Barbour (où l’on sera allé voir des bottes de pluie) au Whitney Museum (pour voir « des courts-métrages d’avant-garde de Robert Beavers »), mais aussi l’adaptation télévisée de Retour à Brideshead, le duo d’electro écossais Boards of Canada, « le Radiohead de la fin des années 1990/l’inquiétude globale/les aéroports » et le New Jersey. Une « vibe » se révèle donc être quelque chose comme une « couleur locale » dotée d’une dimension historique. Ce qui confère de l’« authenticité » à une vibe réside dans sa capacité à évoquer – à travers un petit nombre d’éléments disparates – un certain temps, un certain lieu et un certain milieu ; un certain nœud de forces historiques, géographiques et culturelles6.
À mon sens, la signification d’une œuvre littéraire, qu’il s’agisse de l’Enfer de Dante, d’En Attendant Godot de Beckett ou de Tendres boutons de Stein, réside au moins en partie dans une « vibe » ou un style esthétiques que l’on peut percevoir quand on considère la totalité des objets et des phénomènes qui constituent le paysage imaginaire de l’œuvre comme une sorte d’ensemble choisi et agencé. Par exemple, la signification de l’Enfer de Dante se trouve en partie dans ce je-ne-sais-quoi qui rend chaque âme, chaque démon, chaque machine de la vision dantesque de l’enfer adéquats à la vision dantesque de l’enfer. De la même façon, la signification d’En attendant Godot réside en partie dans ce qui limite à nos yeux l’espace des choses que Vladimir et Estragon peuvent dire et faire à un ensemble restreint de possibilités quasiment épuisées par la pièce. Une part de la signification de Tendres boutons réside dans l’ensemble d’objets et de phénomènes (peut-être intrinsèquement linguistiques) se conformant à Tendres boutons7.
5. Les caractéristiques, ou les dimensions, ou les « respects de variation » d’un auto-encodeur entraîné sont très semblables à une liste fixe de prédicats à côté desquels on peut écrire, par exemple, « non », « quelque peu », « solidement », « extrêmement »8. Dans le contexte de la fonction caractéristique, qui produit des « résumés » de l’objet entré, il est tout naturel de concevoir les « respects de variation » comme des prédicats descriptifs. Les caractéristiques d’un auto-encodeur entraîné revêtiront une signification assez différente si nous nous focalisons sur la fonction décodeur, qui transforme les « résumés » en reconstructions. Du point de vue de la fonction décodeur, une liste donnée de valeurs caractéristiques n’est pas un « résumé » susceptible d’être appliqué à un nombre quelconque d’objets étroitement liés, mais, pour ainsi dire, l’ADN d’un objet spécifique. Les caractéristiques ou les « respects de variation » d’un auto-encodeur entraîné sont, de ce point de vue, semblables à une liste de prédicats impératifs, des techniques ou principes structurels que le constructeur doit appliquer. Pour le décodeur, les « formules génératives » d’objets dans le canon d’un auto-encodeur entraîné sont des listes de valeurs d’activation qui déterminent l’intensité avec laquelle le processus de construction (la fonction décodeur) applique chaque technique ou principe structurel disponible.
6. Le canon de n’importe quel auto-encodeur entraîné a par conséquent une propriété fondamentale : tous les objets qu’il contient s’alignent sur un vocabulaire génératif limité. Par implication, les objets qui constituent le domaine mondain effectif de l’auto-encodeur entraîné s’alignent approximativement sur ce même vocabulaire génératif limité. J’avancerai que ces relations structurelles d’alignement sont étroitement liées entre elles et peuvent entretenir une relation forte à certains concepts d’unité esthétique qui impliquent communément une unité de logique générative, tels ceux de « style » ou de « vibe », au plan intuitif ou dans la théorie littéraire. Être un ensemble qui s’aligne sur quelque vocabulaire génératif logiquement possible n’est guère une propriété structurelle ou esthétique « réelle », étant donné l’infinité des vocabulaires génératifs logiquement possibles. En revanche, être un ensemble qui s’aligne sur quelque vocabulaire génératif limité (logiquement possible) est une propriété intersubjective robuste.
7. Grâce à une puissante paraphrase, on pourrait dire que les objets qui constituent le canon d’un auto-encodeur entraîné sont individuellement complexes mais collectivement simples. On peut, pour donner une meilleure illustration de ce concept (« individuellement complexe mais collectivement simple »), faire une rapide digression et décrire un projet artistique mathématique et visuel typiquement associé à la culture hacker de la fin du siècle passé : l’« intro 64k ». Dans la sous-culture artistique et mathématique que l’on appelle « scène démo », une « intro 64k » est un monde visuel riche, immense et nuancé, mais qui loge dans 64 kilooctets de mémoire, voire moins, soit mille fois moins que la mémoire standard requise pour produire un monde visuel riche, robuste et nuancé. Dans une intro 64k, une centaine de lignes de code créent un univers sensoriel complexe en utilisant, très littéralement, les affinités ésotériques des surfaces avec des Idées primordiales. Le code d’une intro 64k utilise l’inventaire le plus restreint possible de schémas initiaux pour générer les objets concrets les plus divers. La magie informatico-théorique sur laquelle repose une intro 64k réside dans le fait que, un peu comme une fugue spatiale, ces mondes sont des tapisseries constituées de motifs interdépendants et similaires les uns aux autres. Du niveau topologique (architecture et mouvement de caméra) au niveau moléculaire (les polygones et textures dont les objets sont faits), tout, dans une intro 64k, naît d’un « air de famille » entre les formes.
8. De façon remarquable – et peut-être aussi triviale –, on peut prouver que la relation entre exprimabilité succincte et profondeur de motif que l’on trouve dans les intros 64k vaut pour n’importe quel système informationnel, cognitif ou sémiotique. En théorie de l’information, la « complexité de Kolmogorov » est un moyen conceptuellement très utile, bien que souvent lourd à manipuler sur le plan technique, de mesurer la « profondeur de motif » : la complexité de Kolmogorov d’un objet correspond à la longueur de la description la plus courte (dans un système sémiotique donné) nécessaire pour le spécifier intégralement9. Génériquement, une complexité de Kolmogorov faible implique un motif plus fort. Une complexité de Kolmogorov faible – c’est-à-dire une description réduite à la longueur la plus courte – pour un objet, relativement à un système sémiotique donné, implique l’existence de motifs profonds dans l’objet, ou une relation étroite entre l’objet et les concepts élémentaires du système sémiotique.
9. Lorsque tous les objets inclus dans un ensemble donné C ont une complexité de Kolmogorov+ faible relativement à un système sémiotique donné S, on dira que le système sémiotique S est un schéma de C. Si S est le langage génératif (en termes formels, la fonction décodeur) d’un auto-encodeur entraîné, et C le canon de cet auto-encodeur entraîné, par exemple, alors S est un schéma de C. Point important, n’importe quel schéma S est en soi un objet sémiotique et possède une complexité de Kolmogorov relativement à notre système sémiotique présent. Donc l’efficacité « réelle » – c’est-à-dire l’efficacité relativement à notre système sémiotique – de S comme schéma d’un objet c dans C est mesurée par la somme de la complexité de Kolmogorov+ de c relativement à S et de la complexité de Kolmogorov de S. Mais parce que l’on a seulement besoin d’apprendre un langage une fois pour pouvoir l’utiliser pour créer autant de phrases que l’on souhaite, quand on considère l’efficacité de S comme schéma d’objets multiples c1, c2, c3 dans C, nous n’ajoutons pas de façon répétée la complexité de Kolmogorov de S aux complexités de Kolmogorov+ respectives de c1, c2, c3 relativement à S pour en faire la somme. Au contraire, on n’ajoute qu’une seule fois la complexité de Kolmogorov de S à la somme des complexités de Kolmogorov+ respectives de c1, c2, c3 relativement à S. Le canon d’un auto-encodeur entraîné, nous l’avons dit, comprend des objets individuellement complexes mais collectivement simples. Ou, pour formuler cette idée différemment, à mesure que l’on considère des collections de plus en plus grandes d’objets contenus dans le canon d’un auto-encodeur entraîné C et que l’on spécifie les objets pertinents en utilisant notre système sémiotique, on atteint rapidement un point où le moyen le plus court de spécifier les objets collectés consiste d’abord à établir le langage génératif de l’auto-encodeur entraîné S, puis à spécifier succinctement les objets utilisant S.
10. Supposons qu’une personne saisisse un style ou une vibe dans un ensemble de phénomènes du monde. Une partie de ce qu’elle saisira peut se comparer aux formules de l’auto-encodeur entraîné à partir de cette collection. Par conséquent, le canon de cet auto-encodeur entraîné abstrait serait une idéalisation de l’ensemble mondain, dont il intensifierait la logique interne. Ou, à l’inverse, on pourrait envisager l’idée selon laquelle lorsque le paysage imaginaire d’une œuvre littéraire possède une forte unité de style, l’unité esthétique de la collection artefactuelle est potentiellement l’idéalisation d’une unité esthétique plus diffuse et plus faible entre les objets ou phénomènes associés avec un domaine du monde réel que l’œuvre d’art encode. Dans le cas de l’auto-encodeur, nous savons traiter la collection artefactuelle d’objets ou de phénomènes – le canon de l’auto-encodeur entraîné, mathématiquement équivalent à l’auto-encodeur entraîné lui-même – comme une représentation gestaltique systémique et structurelle d’un ensemble mondain dont il idéalise la vibe. En appliquant le même raisonnement au cas littéraire, on pourrait conjecturer qu’une vibe dense dans le paysage imaginaire associé à une œuvre d’art agit potentiellement comme représentation structurelle de la vibe diffuse des objets et phénomènes collectifs d’un domaine du monde réel. J’avancerai donc, de la même façon, que la « structure esthétique dense » en question fournit potentiellement un schéma d’interprétation des objets et phénomènes d’un domaine du monde réel, en accord avec une « gestalt systémique » livrée dans le paysage imaginaire de l’œuvre littéraire.
11. Il est logiquement possible de partager directement la formule d’un auto-encodeur entraîné, en énumérant chaque partie du substrat d’un réseau de neurones. Mais c’est une très mauvaise idée d’essayer de le faire : les calculs impliqués dans l’auto-encodage, sans parler des processus bio-cognitifs abstraitement semblables à l’auto-encodage, sont particulièrement difficiles sur le plan mathématique et obliques sur le plan conceptuel. Si ce qu’une personne saisit en saisissant l’« unité esthétique » ou la vibe d’une collection de phénomènes est, même en partie, le fait que cette collection de phénomènes peut être approximée en utilisant un langage génératif limité, alors on ne peut espérer exprimer ou partager ce que nous avons saisi sous sa forme abstraite. En revanche, il existe un fait mathématique concernant les réseaux de neurones et que des créatures comme nous, constituées de réseaux de neurones, peuvent aisément utiliser : l’identité pratique entre un auto-encodeur entraîné et son canon. Si la saisie d’une vibe mondaine diffuse possède la forme d’un auto-encodeur entraîné, alors nous devrions pouvoir partager, les uns avec les autres, l’appréhension de cette vibe, en construisant intersubjectivement un ensemble approprié de phénomènes idéalisés. En même temps, on doit aussi s’attendre à ce que l’« idée » exprimée par notre ensemble construit de phénomènes idéalisés soit essentiellement impossible à paraphraser ou à séparer de sa forme expressive, en dépit du caractère mondain de son objet.
12. Par conséquent, une vibe est en ce sens une entité abstraite (abstractum) inséparable de ses entités concrètes (concreta). De façon révélatrice, bien que non intentionnelle, la formulation précédente reprend, en l’inversant, une certaine formulation de la « théorie romantique du symbole », celle que l’on trouve, par exemple, chez Goethe, qui définit le symbole comme « révélation vivante et momentanée de l’impénétrable » dans un particulier, de sorte que « l’idée demeure éternellement et infiniment active et inaccessible [wirksam und unerreichbar] dans l’image, et [qu’]elle demeurerait inexprimable, même si elle était exprimée dans toutes les langues [selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unauspprechlich bliebe]10». Pour clarifier encore le rapport de notre trope philosophico-littéraire (la « vibe») au « Symbole », trope philosophico-littéraire romantique, considérons la paraphrase encore plus concise qu’en a proposé Yeats un siècle plus tard, au moment où le symbole romantique achevait, dans le symbolisme anglais très tardif, le long voyage transeuropéen qu’il avait entamé au début du romantisme allemand : « Un symbole est en effet la seule expression possible de quelque essence invisible, une lampe transparente portant une flamme spirituelle11. »
13. Une question vient alors à l’esprit : l’idée d’une entité abstraite inséparable de ses entités concrètes n’est-elle qu’une réaffirmation de la théorie du symbole défendue par Goethe et Yeats, mais en sens inverse, dans la mesure où elle pose un type d’entité abstraite (une « structure de sentiment ») qui ne peut s’exprimer que dans un particulier, plutôt qu’un type de particulier (un « symbole ») exprimant de façon singulière une abstraction ? Je poserai que ce n’est pas vraiment le cas, et même que la différence entre les deux est essentielle pour comprendre l’affinité élective unissant la vibe et l’art poétique spécifiquement moderniste.
14. Bien qu’elle entretienne de très nombreuses continuités avec le symbolisme et le romantisme, l’époque de Pound, Eliot, Joyce et Stein est marquée par l’ascendant d’une certaine réorientation matérialiste de la tradition symboliste/romantique. Le sens que Daniel Albright donne au mot « matérialiste » dans son étude consacrée aux emprunts de la théorie poétique moderniste à la chimie et à la physique est tout à fait pertinent, mais « non platonicien12 », ou « immanent », au sens deleuzien, constitue une signification pertinente plus générale. Si l’on se rappelle que Joyce et Zukofsky étaient de grands fans d’Aristote, et si l’on remarque que la phrase de William Carlos Williams, « il n’y a d’idées que dans les choses13», constitue peut-être la meilleure traduction possible de l’expression latine « universalia in re », on pourrait même s’aventurer à parler d’une réorientation aristotélicienne de la tradition symboliste, dans la théorie et dans la pratique esthétiques.
15. Pour le théoricien moderniste de l’esthétique, la tâche philosophique en matière de poétique change en partie de nature : on passe du problème du platonisme, consistant, grosso modo, à expliquer comment les phénomènes concrets peuvent s’élever jusqu’à une idée abstraite autrement inexprimable, à un problème aristotélicien, qui doit expliquer comment un ensemble de phénomènes concrets est (ou peut être) une idée abstraite. Alors que pour Coleridge, par exemple, l’Imagination14 était la faculté reliant le monde des choses au monde des idées, William Carlos Williams considère l’Imagination comme la faculté qui relie horizontalement les choses entre elles pour créer un monde. D’un point de vue aristotélicien, l’opération poundienne/eliotienne – ou, de façon moins canonique mais plus adéquate, steinienne – par laquelle la poésie agence ou agrège explicitement des objets conformément à des partitions nouvelles et inhabituelles15 est précisément ce que signifie représenter pleinement et directement des entités abstraites : une entité abstraite est juste l’affinité des objets contenus dans une classe. En fait, dans « New Work for a Theory of Universals », David Lewis, le premier des matérialistes scolastiques contemporains, avance que les universels sont simplement des « classes naturelles », métaphysiquement identiques à des ensembles d’objets possédant des affinités structurelles internes.
16. Pour illustrer la production par une œuvre littéraire des symboles « horizontaux » que l’on a décrits, on pourrait considérer le paysage imaginaire contenu dans le corpus de Franz Kafka. À mon sens, il n’est pas particulièrement scandaleux de poser qu’il opère précisément comme un schéma esthétique de l’unité ou de l’affinité d’une collection de phénomènes du monde réel. Le lecteur de Kafka apprend à voir une sorte d’esthétique kafkaïenne dans diverses expériences, aller à la banque, se faire plaquer, se réveiller l’esprit confus, se sentir perdu dans une ville inconnue, subir un interrogatoire de police, en partie parce qu’il apprend qu’un nombre étonnamment grand de nuances de ces expériences dans la vie réelle peut être adéquatement approximé dans un monde littéraire dont les construits reposent tous sur les règles esthétiques de la construction kafkaïenne. Nous apprenons, en d’autres termes, à saisir une logique esthétique kafkaïenne dans certains phénomènes mondains, pour partie en apprenant que la logique esthétique pure kafkaïenne du monde littéraire de Kafka peut générer des ressemblances étonnamment bonnes avec ces phénomènes mondains.
17. Ce bref passage par Kafka et l’incontournable prédicat « kafkaïen » nous donne aussi une bonne occasion de repérer une relation intéressante entre signification ambiante, polyvalence littéraire et processus d’apprentissage de concepts. Considérons que le concept de « polyvalence », forgé à la fin du symbolisme français et au début des avant-gardes parisiennes, inclut à la fois les phénomènes de collage, d’hybridité et de polyphonie (où la multiplicité hétérogène est étalée sur la page) et les phénomènes d’indétermination, d’indécidabilité et d’ambiguïté (où la multiplicité hétérogène émerge dans le processus de lecture). Selon la position suggérée ici, un objet littéraire polyvalent et vibe-cohérent fonctionne comme modèle concret quasi minimal de la structure abstraite commune aux expériences, objets ou phénomènes disparates recouverts par l’objet polyvalent, ce qui nous permet d’unifier ces divers phénomènes mondains sous un prédicat – le « kafkaïen », par exemple. Les cas paradigmatiques de ce travail cognitif sont inévitablement ceux qui se sont rendus invisibles grâce à la profondeur de leur impact, où la lexicalisation du concept généré esthétiquement obscurcit le processus esthétique qui le sous-tend constitutivement : nous avons naturellement tendance à donner à telle difficulté personnelle ou institutionnelle le prédicat de « kafkaïenne », à telle conservation celui de « pinterienne », à telle situation énigmatique celui de « borgésienne ». (J’attends qu’entre en circulation le prédicat « ackerien16 » et qu’il permette enfin de nommer la vie contemporaine, mais, comme on le sait, la chouette de Minerve ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit.)
18. Le meilleur pont conceptuel entre l’« unité esthétique » brute que nous avons associée au canon d’un auto-encodeur et la modélisation gestaltique systémique de la réalité que nous associons à la forme computationnelle d’un auto-encodeur entraîné réside peut-être dans ce qu’on pourrait appeler la relation de comparabilité de tous les objets contenus dans le canon d’un auto-encodeur entraîné. Je dirais que l’unité esthétique globale des objets d’un ensemble adapté à l’auto-encodage est inséparable, sur le plan technique mais aussi sur les plans conceptuel et phénoménologique, de l’intercomparabilité globale des objets du multiple, et que l’intercomparabilité globale des objets du multiple est inséparable, sur le plan technique mais aussi sur les plans conceptuel et phénoménologique, de la représentation d’un système.
19. Dans la phénoménologie de la lecture, nous éprouvons pour ainsi dire cette « mêmeté de la différence » comme première, et l’« unité esthétique » du paysage imaginaire d’une œuvre littéraire comme dérivée. Le « style » ou la « vibe» d’une œuvre littéraire s’identifie d’abord à la structure invariante des transformations et transitions qui constituent le mouvement narratif et rhétorique de l’œuvre. Par exemple, lorsque nous lisons Lenz de Georg Büchner, l’intrigue évolue, les processus lyriques du psychisme de Lenz se transforment, Lenz change de site matériel et social, et chaque changement consolide et clarifie la constance tonale de niveau supérieur. Nous avons posé que le style ou la vibe invariants d’une œuvre littéraire donnée est le corrélat esthétique de l’espace des possibles interne de cette œuvre. Du point de vue du lecteur, cet espace des possibles est une extrapolation de l’espace des transformations qui encode la logique de la « machine à différences » de l’œuvre, machine narrative, lyrique et rhétorique. Ou, pour le dire de manière plus prosaïque : saisir un « style » ou une « vibe » devrait signifier, tout autant qu’une capacité à juger si un ensemble d’objets ou de phénomènes possède ou ne possède pas, collectivement, un style donné, une capacité à juger de la différence entre deux objets (conformes au style) en rapport à son cadre.
20. Apprendre à percevoir un système et apprendre à percevoir en relation à un système – apprendre à voir un style et apprendre à voir en relation à un style –, c’est, auto-encodeurs ou non, plus ou moins la même chose. Si ce que l’on a posé est juste, et si l’« unité esthétique » associée à un « style » ou à une « vibe » est immédiatement une représentation sensible d’une logique de différence ou de changement, alors l’accès fonctionnel aux capacités d’analyse de données de la fonction caractéristique et de l’espace de représentation abstrait et de petite dimension d’un auto-encodeur entraîné s’ensuit, à très long terme, ne serait-ce que pour la seule « perception de style » ou « perception de vibe» adéquates, puisque la totalité des distances de l’espace de représentation entre les points de l’espace d’entrée répare logiquement la fonction caractéristique. Sur un plan plus pratique, l’accès à la différence de l’espace de représentation, et même à la seule distance de l’espace de représentation, est – si l’espace de représentation est fondé sur un schéma de compression avec forte perte pour le domaine – suffisant en pratique pour un puissant apprentissage « transductif17 » de la classification concrète et des compétences de prédiction dans le domaine. Quand donc nous saisissons la « vibe » diffuse d’un domaine mondain de la vie réelle via son idéalisation comme « style » ou « vibe » d’une œuvre littéraire ambiante, nous faisons vraisemblablement une « cartographie cognitive » équivalente à celle de la métrique d’un schéma de compression avec forte perte.
21. À mon sens, l’une des raisons pour lesquelles le trope mathématico-cognitif de l’auto-encodage importe réside dans le fait qu’il décrit l’acte pur et premier consistant à traiter une collection d’objets ou de phénomènes comme ensemble d’états d’un système plutôt que comme une pure collection d’objets ou de phénomènes – la systématisation minimale et ambiante qui élève un matériau (stuff) au rang de chose et les choses au rang de monde, et une chose après une autre au rang d’expérience. (Et, également, la systématisation minimale et ambiante qui efface le matériau non conforme au nom de l’autorité des choses, marginalise les choses non conformes pour faire un monde, fait dégénérer l’expérience en fausse conscience18.)
22. En reliant les points de l’espace d’entrée du multiple d’un ensemble à des points dans l’espace interne de petite dimension du multiple, le modèle d’un auto-encodeur établit une distinction fondamentale entre phénomènes et noumènes qui fait des points de l’espace d’entrée du multiple la gamme des états visibles d’un système plutôt qu’un simple ensemble arbitraire de phénomènes. En ce sens, on peut affirmer que l’« unité esthétique » parallèle dans un monde ou dans une œuvre d’art – ce que nous avons appelé sa « vibe» – est quelque chose comme une variante « virtuelle » maximale de la tonalité (Stimmung) heideggérienne. Si une tonalité est une « vue présumée de l’image d’ensemble » (Flatley) qui conditionne toute attitude spécifique à l’égard de toute chose particulière, l’unité esthétique (qui associe les objets ou phénomènes rassemblés d’un monde ou d’une œuvre avec un espace de possibles qui donne une signification aux objets ou phénomènes individuels qui le constituent en les reliant à une totalité) constitue une cognition sensible de quelque chose comme la Stimmung d’un système – et, de façon très similaire à la Stimmung, ceci constitue la « précondition et le medium de19» toutes les opérations plus spécifiques de la subjectivité. Ce que fournit un auto-encodage, c’est quelque chose comme la systémicité fondamentale du système, sa particularité primordiale. Sa vibe propre.